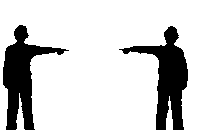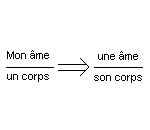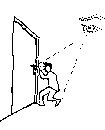|
...... |
...... |
...... |
||||||||
|
..... |
II. L'intersubjectivité primordiale III. Le désir IV. La parole V. La dimension éthique de la reconnaissance d'autrui
I. L'AUTRE SUJET COMME PROBLÈME 1. L'inférence analogique Comment peut-il exister un autre sujet que moi-même? Ce problème (plutôt vertigineux) apparaît assez naturellement dans une perspective cartésienne. La certitude réflexive du cogito, telle que Descartes la concevait, est au départ un fondement solitaire puisque je suis seul à pouvoir exercer cette réflexion prétendument adéquate. Descartes croit pouvoir éviter le solipsisme de la manière suivante. Il est, d'une part, possible d'être certain de l'existence du corps d'autrui comme chose étendue grâce au critère de l'idée claire et distincte et à la garantie de la véracité divine. D'autre part, pour y reconnaître un autre être pensant, on effectue une démarche non perceptive mais intellectuelle. 2. La gêne d'être regardé
"Imaginons,
écrit Sartre, que j'en sois venu, par jalousie, par intérêt, par vice,
à coller mon oreille contre une porte, à regarder par le trou de la
serrure. Je suis seul et sur le plan de la conscience non-thétique (de)
moi. Cela signifie d'abord qu'il n'y a pas de moi
pour habiter ma conscience. Rien, donc, à quoi je puisse rapporter mes
actes pour les qualifier. Ils ne sont nullement connus, mais je les
suis et, de ce seul fait, ils portent en eux-mêmes leur totale justification
(...). Or, voici que j'ai entendu des pas dans le corridor : on me regarde.
Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que je suis soudain atteint dans
mon être et que des modifications essentielles apparaissent dans mes
structures - modifications que je puis saisir et fixer conceptuellement
par le cogito réflexif (...). Cela signifie que j'ai tout d'un
coup conscience de moi en tant que m'échappe, non pas en tant que je
suis le fondement de mon propre néant, mais en tant que j'ai mon fondement
hors de moi (...). C'est la honte ou la fierté qui me révèlent le regard
d'autrui et moi-même au bout de ce regard (...). Je ne puis avoir honte
que de ma liberté en tant qu'elle m'échappe pour devenir un objet donné"
La signification de mon corps est donc modifiée. Avant, je n'avais pas un corps, je "l'existais"; il n'était pas chose, mais accès aux choses. Maintenant, je réfléchis : j'apprend que mon corps-sujet est aussi un objet au milieu du monde, puisqu'il a permis à l'autre de me voir et d'interpréter mon comportement à sa guise. Notre conscience de l'existence d'autrui est contemporaine de notre conscience réflexive de nous-mêmes. On connaît le mot de la pièce Huis-Clos : "l'enfer, c'est les autres". Le cercle infernal est que, d'une part, autrui m'objective sous certaines qualifications alors que ma liberté est "un refus indéfini d'être quoi que ce soit" et que, d'autre part, pour affirmer néanmoins ma liberté, je constitue à mon tour l'autre en objet en le qualifiant à ma façon : il est coléreux, généreux, lâche, etc... Sartre n'exclut toutefois pas la possibilité d'une réciprocité d'être libres qui se reconnaissent tels. Les libertés sont solidaires dans leur reconnaissance comme dans leur méconnaissance. Cependant, cette reconnaissance réciproque est une tâche difficile dans laquelle le moment de la négation, sous une forme ou sous une autre, paraît inévitable. Hegel avait déjà affirmé que la lutte des consciences appartenait à la dialectique du désir d'être reconnu.
________________________________________________ |
...... |
||||||||